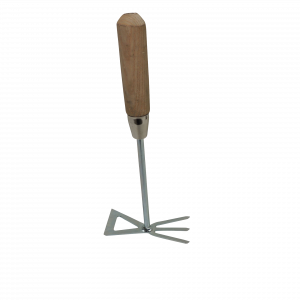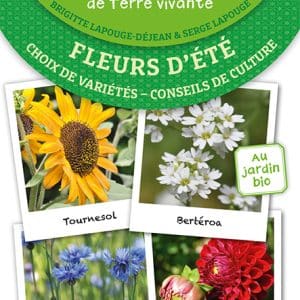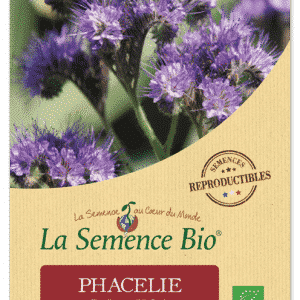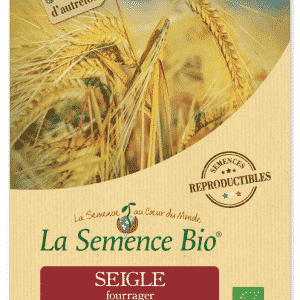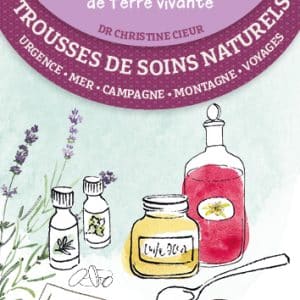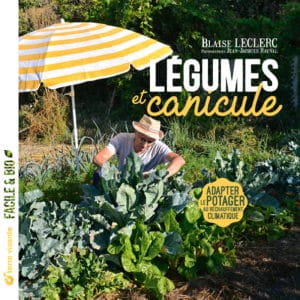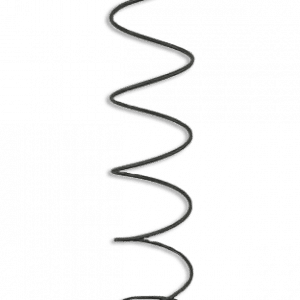Par Damien Lehman, poêlier, formateur et laborantin
Pour caractériser les performances d’un appareil, il est obligatoire de mesurer les polluants atmosphériques (COV et PM – en anglais, Particulate Matters signifie « particules fines ») et non plus les seuls rendement et taux de CO. La France n’a jamais écrit sa propre norme pour la mesure d’émissions des poêles à bois.
Depuis 2009, les fabricants de poêles « série » sont tenus de tester leurs appareils selon l’une des trois normes en vigueur en Europe : l’austro-allemande, la norvégienne ou l’anglaise. C’était un problème car, selon le protocole de la norme utilisée, un même poêle présentait des résultats finaux différents. Depuis 2018, une nouvelle norme, NF EN 16510-1, uniformise les protocoles de mesures sur tout type d’appareil de chauffage domestique à combustion solide vendu en Europe. Elle est entrée en application en 2023 avec la publication de sous-parties qui détaillent les modalités de mise en œuvre pour chaque type d’appareil. On attend encore celles concernant les appareils à libération lente de chaleur et les appareils mixtes bûche et pellet.
Il est important de comprendre que les mesures d’émissions sont très variables dans les phases d’allumage. Pour bien les quantifier, il faudrait multiplier les essais et les moyenner, ce qui demanderait des dizaines d’essais par appareil et aurait un coût exorbitant. Les COV et PM ne sont donc pas mesurés pendant le cycle d’allumage, mais uniquement sur un rechargement dans un foyer chaud, lorsque le régime nominal est atteint (feu bien établi). Le but est de pouvoir comparer les appareils entre eux, en s’approchant le plus possible d’une utilisation en conditions réelles (qui comprend de nombreux rechargements sur la plupart des appareils).
Pour des questions pratiques et financières, le démarrage n’est tout simplement pas pris en compte (alors que c’est la phase la plus polluante). Mais pas de conclusion hâtive, il ne s’agit pas d’un nouveau « Dieselgate » : la norme impose tout de même une mesure d’émissions pour les appareils dont la notice précise qu’ils sont capables de régimes ralentis. Il est tout simplement impossible pour un laboratoire d’évaluer toutes les variantes possibles d’installation, d’usage, de conditions extérieures, de qualité de combustible, de facteur humain, etc.
Pour les poêles de masse, la publication a été repoussée à cause d’un point de blocage majeur : un poêle de masse n’a pas vraiment de phase de mise en régime nominal après rechargement d’un foyer chaud. Il était question pour les appareils sans rechargement de prendre en compte l’intégralité du test, ce qui les aurait pénalisés par rapport aux autres types en incluant les émissions d’un démarrage à froid. Ces subtilités de protocole sont susceptibles de dégrader fortement le classement des poêles de masse, voire de pousser les fabricants à revoir leur principe de fonctionnement en adoptant des foyers plus petits qu’il faudra recharger…
La prise en compte de l’intégralité du cycle de combustion pour tous les appareils, en acceptant la variabilité et en optimisant la méthode de démarrage, aurait été bienvenue. On voit à quel point il est important de s’investir pour peser lors des travaux normatifs, car ils façonnent les pratiques et les appareils.
En matière d’émissions, la règle à suivre est : « pas de régime ralenti avec un appareil qui n’est pas prévu pour », c’est-à-dire à peu près tous ! Et pour ne pas faire de ralenti sans suffoquer dans sa maison, rien de mieux qu’un poêle de masse !