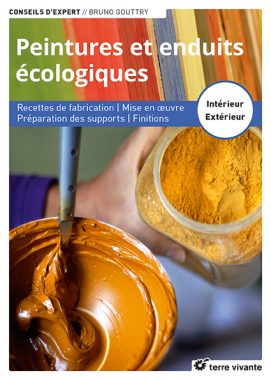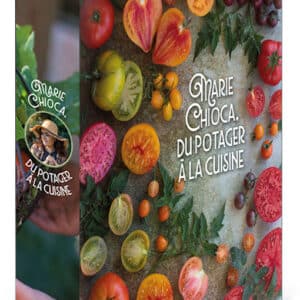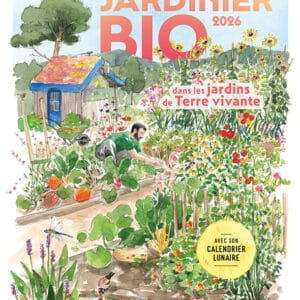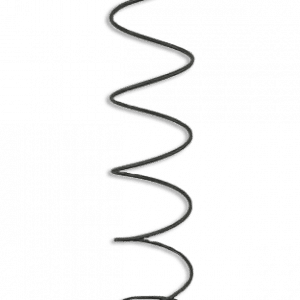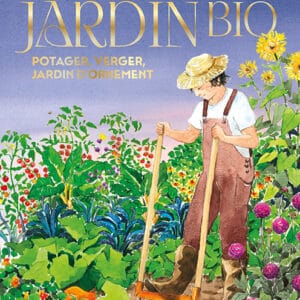B. Gouttry |
Nous trouvons sur les rayonnages des magasins spécialisés en décoration de plus en plus de peintures dites écologiques. Mais que signifie ce mot ? Que la peinture est faite de matières premières naturelles ? Que sa fabrication respecte l’environnement ? Que son utilisation préserve la qualité de l’air intérieur ? Ou, simplement, qu’elle entre dans une réglementation si mal définie que l’on peut y trouver tout et n’importe quoi ? La législation autorise l’utilisation de l’appellation peinture écologique à partir du moment où sa teneur en COV (composés organiques volatils) est inférieure à 30 g/l, et son liant contient entre 20 et 90 % de matière première naturelle. Partant de ce principe, beaucoup d’industriels en profitent pour proposer des peintures “vertes”… qui, en réalité, restent toujours à base de produits pétroliers, polluants à la fabrication, à l’utilisation et surtout en fin de vie par leur décomposition en fine poussière plastique que l’on retrouve dans l’air et dans l’eau.
Alors comment être sûr d’utiliser une peinture vraiment écolo ? La première solution est de fabriquer soi‑même ses peintures (lire recettes ci-dessous). On contrôle ainsi plus facilement les matières premières utilisées (caséine, huile végétale, pigment naturel…) ; mais cela demande un minimum de connaissance et un peu de matériel. Seconde solution, lire les étiquettes des pots de peinture, qui sont souvent une mine d’informations : domaine d’utilisation, temps de séchage, support, application, matériel et surtout composition complète du produit. Si cette dernière mention n’apparaît pas, est très vague ou compliquée à comprendre, passez votre chemin. Tout fabricant se doit d’être clair avec le consommateur, surtout dans le domaine du naturel. S’il ne l’est pas, c’est sûrement qu’il a quelque chose à cacher.
Bien lire les étiquettes
De nombreuses marques de vraie peinture naturelle sont disponibles sur le marché. Mais attention à ne pas tomber dans le panneau : derrière le terme “naturel” peuvent se cacher des produits de synthèse ; soyez vigilant à la lecture des étiquettes.
B. Gouttry |
Composition : elle doit être claire et compréhensible. Attention, derrière des termes comme “naturel” peuvent se cacher des produits de synthèse, à base de résine, liant, végétal biosourcé (à quel pourcentage ? Comment sont‑ils transformés pour être mélangés à l’eau ?). À propos du latex, sachez que seul l’hévéa est naturel… mais vu son prix, le latex est la plupart du temps synthétique.
Acide acétique, vinaigre et acide de vin : cette mention peut cacher des acétates de polyvinyle. Enfin, l’isoparafine est un résidu du pétrole. En cas de doute, vous pouvez demander au commerçant (ou chercher sur internet) la fiche de données de sécurité (FDS), obligatoire mais pas toujours accessible.
Diluable à l’eau : ce n’est pas parce qu’une peinture est à l’eau qu’elle est naturelle. L’acrylique présent dans la majorité des peintures synthétiques se dilue à l’eau ; l’époxy aussi se dilue à l’eau et, pourtant, ces deux produits sont d’origine pétrolière.
Sans odeur : cela ne garantit pas la neutralité du produit. Il est toujours préférable de renouveler l’air d’une pièce lorsque celle‑ci est fraîchement peinte. Des agents antiodeurs peuvent aussi être glissés dans la composition de la peinture.
Pour l’extérieur, les laques naturelles à l’huile de lin vieillissent mieux et sont moins polluantes que leurs homologues de synthèse.
B. Gouttry |
Lessivable : peu – ou pas ! – de peintures murales naturelles sont lessivables ; seuls les produits de type laque et celles riches en huile végétale (satinée et brillante) peuvent l’être. Les autres doivent sûrement contenir un liant synthétique, qui permet ce lessivage.
Émissions de COV : cet étiquetage indique le niveau de COV (A+, A, B, C) 28 jours après l’application de la peinture, et seulement pour une dizaine d’entre eux, alors qu’il en existe plus d’une centaine ! Visez une teneur de 6 g/l maximum. Dans les faits, la plupart des peintures du marché ont la mention A+. Les peintures naturelles ont l’avantage de ne dégager aucun produit après leur séchage complet. Il faut environ 8 à 10 jours pour qu’une peinture naturelle soit sèche à cœur ; au‑delà, que ce soit une peinture avec solvant ou bien à l’eau, aucune émanation ne se retrouvera dans l’air intérieur.
Durant le temps de l’utilisation, certains produits (caséine, huile végétale, essence d’agrume…) peuvent provoquer des allergies ou des gênes passagères (odeur forte des solvants). Il est donc important de bien ventiler les pièces pendant les travaux et de connaître la composition des produits utilisés.
Les labels : mis à part pour les labels allemands L’ange bleu, Natureplus et Öko‑test, qui restent des références, les contrôles sont peu exigeants… voire plus effectués. Pour plus de sûreté, évitez les grandes surfaces de bricolage et préférez les achats en magasins de produits spécialisés.
Peintures en poudre ou liquides ?
Les peintures en poudre sont très certainement les plus saines sur le marché du naturel. Même si elle est cachée derrière les couches de finition, la sous-couche doit elle aussi être saine.
B. Gouttry |
Si une peinture à l’eau est composée uniquement de matières premières naturelles et organiques, les bactéries vont s’y développer rapidement. Il est donc indispensable, dans ce cas‑là, d’utiliser des conservateurs. Les peintures à base de chaux, ou qui contiennent un solvant (essence ou alcool), n’en ont pas besoin. Les préparations en poudre n’ont pas ce problème et sont très certainement les plus saines sur le marché du naturel car, en l’absence d’humidité, le risque de pourrissement est considérablement réduit.
Ne négligez pas la sous‑couche, très certainement la plus importante dans des travaux de peinture. Elle permet d’uniformiser les supports et facilite l’application des couches de finition. Un support ne doit pas avoir de différence de porosité, n’être ni trop absorbant, ni trop lisse. La sous‑couche est là pour remplir ce rôle. Il en existe plusieurs types. Celles que l’on trouve pour les murs et plafonds, sous le nom d’“impression”, sont généralement à base d’eau ; elles doivent être de même composition que les finitions. Encore une fois, il faut bien lire les étiquettes. Pour la préparation des bois (menuiserie, lambris …), elles portent le nom de primaire ou imprégnation ; elles sont souvent à base de solvants, pour bien pénétrer dans le végétal et bloquer les éventuelles taches de tanins. Dans ce cas, bien ventiler la pièce durant les premiers jours.
Bruno Gouttry
Et pour les menuiseries ?
Pour la protection et la décoration des supports en bois, il existe plusieurs types de finition : l’huile et le vernis (transparent), la lasure (transparente et teintée) et la laque (opaque et teintée). Tous ces produits peuvent être fabriqués avec des matières premières naturelles ; mais pas n’importe lesquelles ! Ils doivent résister aux intempéries lorsqu’ils sont utilisés en extérieur (volet, fenêtre) et surtout aux chocs et salissures quotidiennes, lorsque les peintures sont appliquées sur des portes de passage. De plus, leurs finitions doivent être pénétrantes, pour protéger en profondeur, et surtout souples, après séchage, pour suivre les déformations que subit le support au fil de l’année (changement de température, de taux d’humidité, ouverture‑fermeture).
La peinture doit être solide, souple et facilement lavable. Riches en huile végétale, les peintures naturelles pour le bois répondent à toutes ces conditions. Sur le marché, il en existe deux sortes : les produits sans solvant, qui sont diluables à l’eau, et ceux avec solvant, diluables avec une essence. Les finitions sans solvant ont l’avantage de sécher plus vite, d’avoir une faible odeur, et le matériel est lavable à l’eau. En revanche, celles à l’huile (avec solvant) sont plus couvrantes et sèchent plus lentement, ce qui permet au produit de mieux pénétrer, de pouvoir être travaillées plus longtemps sans risque de reprise, pour un résultat plus uniforme ; je les recommande en rénovation (pour le neuf, les deux conviennent).
Côté santé, les peintures avec solvant dégagent beaucoup de COV mais uniquement les premiers jours ; il faut aérer les pièces la première semaine. Au niveau écologique, on note que les peintures sans solvant contiennent de l’huile “transformée” pour la rendre miscible à l’eau. Ce type d’huile n’existant pas dans le commerce, seules les peintures avec solvant peuvent être faites maison. Il est possible de n’utiliser que peu – ou pas du tout – d’essence pour diluer l’huile ; mais la peinture sera plus difficile à appliquer. Dans tous les cas, on préférera l’essence d’agrume comme solvant.
Peinture suédoise (dite de Falu) pour bois intérieur et extérieur
L’ocre rouge, avec la peinture suédoise, est la plus résistante aux UV.
B. Gouttry |
Appelée aussi peinture à l’ocre ou à la farine, cette peinture un peu grossière est très résistante au temps (aux UV) et aux intempéries. Attention aux bois tanniques (chêne, châtaignier) qui ont tendance à tacher avec des finitions à base d’eau.
Recette (pour environ 1 litre de peinture, entre 8 et 10 m² en une couche) :
- 70 g de farine de riz (pour les couleurs claires) ou seigle (pour les foncées)
- 200 g de pigments (ocre ou terre)
- 20 g de sulfate de fer (uniquement en extérieur)
- 10 cl d’huile de lin ou noix
- 1 cl de savon noir.
– Commencez par faire bouillir l’eau puis ajoutez le sulfate de fer (pour un usage extérieur) ; remuez pour bien dissoudre et attendez la reprise de l’ébullition.
– Ajoutez ensuite la farine en pluie et faites bouillir pendant 30 min. Ne cessez pas de remuer jusqu’à la fin de la préparation. Attention aux éclaboussures chaudes.
– Ajoutez les pigments et laissez chauffer encore 15 min.
– Coupez la cuisson et ajoutez l’huile puis le savon noir.
– Laissez refroidir avant d’utiliser la peinture. Cette peinture étant relativement épaisse, diluez avec un peu d’eau la première couche.
Supports adéquats : bois résineux non raboté ou vieux. Porte de grange, composteur, ruche, cabane, bardage… Ne pas appliquer sur d’anciennes peintures (sauf du même type).
Conservation : cette peinture peut se conserver plusieurs semaines à l’abri de l’air, au sec et au frais.
Temps de séchage à 20 °C : 6 à 12 heures entre chaque couche et 7 jours à cœur.
Peinture à la caséine pour murs et plafonds intérieurs
Recette simple (pour 10 m² en deux couches) :
- 80 g de caséine + 2 c. à café de bicarbonate de soude + 440 g d’eau (ou 1 kg de fromage blanc à 0 % + 2 c. à café de bicarbonate de soude, sans eau)
- 1,2 kg de craie (blanc de Meudon) + 560 g d’eau
- pigments (facultatif).
– Délayez la caséine et le bicarbonate de soude dans l’eau avec un fouet, afin d’éviter les grumeaux, et en prenant soin d’agiter cette préparation vigoureusement pendant 2 min. Laissez gonfler au moins 2 heures.
– En attendant, mélangez la craie et les pigments à l’eau. Utilisez un mélangeur à peinture pour les grandes quantités, afin d’obtenir un meilleur résultat. Ce mélange doit être épais. Laissez reposer.
– Après 2 heures d’attente, mélangez les deux préparations. L’ensemble devient liquide. Laissez reposer encore une demi‑heure. La peinture est prête à l’emploi.
Recette améliorée (pour 10 m² en deux couches) :
- 80 g de caséine acide en poudre
- 40 g de chaux aérienne en poudre (CL90)
- 8 g de méthyle de cellulose en poudre
- 1,2 kg de craie (blanc de Meudon)
- 1,2 kg d’eau.
– Mélangez toutes les poudres entre elles, puis délayez-les vigoureusement dans l’eau, au fouet ou au mélangeur.
– Laissez reposer au moins 2 heures.
– La préparation a épaissi ; ne la diluez pas, sauf si elle paraît trop épaisse lors de l’application.
Si vous souhaitez teinter ces peintures blanches, ajoutez des pigments en ôtant la quantité de craie équivalente. Les pigments étant beaucoup plus coûteux que la craie, plus leur présence sera marquée, moins la peinture sera économique. En règle générale, on utilise au maximum 50 % de pigments.
Supports adéquats : plâtre et plaque de plâtre, recouverts au préalable d’une impression, ou ancienne peinture mate ; elle convient aussi pour recouvrir les enduits de terre et de ciment et peut être utilisée sur le bois peu sollicité, uniquement en intérieur.
Conservation : à l’abri de l’air, au sec et au frais. En présence de chaux, elle se conserve plusieurs semaines ; sinon, 48 à 72 heures maximum.
Temps de séchage à 20 °C : 6 à 12 heures entre chaque couche et 7 jours à cœur.