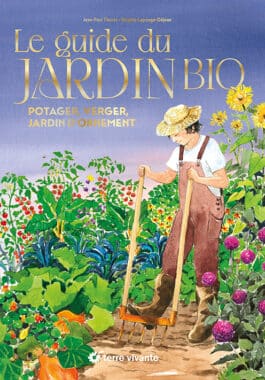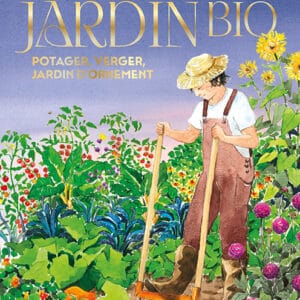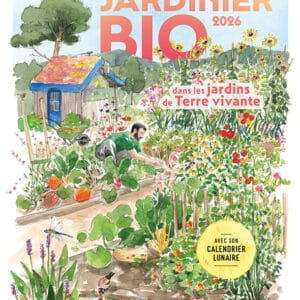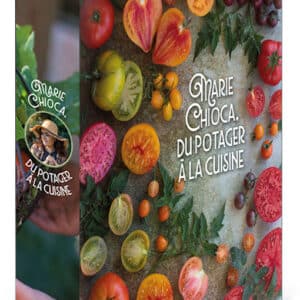J.-J. Raynal |
Cet article est extrait du livre Le guide du jardin bio de Jean-Paul Thorez et Brigitte Lapouge-Déjean.
Pour la partie ornementale du jardin, il est tout à fait possible de s’adapter à n’importe quelle situation : sol sec ou humide, pauvre ou riche, terrain en pente ou plat, bien exposé ou à l’ombre… Il suffit de choisir les plantes en conséquence. Et en ce qui concerne le plan, il pourra être géométrique ou fantaisiste. C’est une affaire de goût et de style. Mais pour ce qui est du potager et du verger, le choix de l’emplacement est extrêmement important. Combien de désillusions n’ont d’autre cause que le non respect des critères suivants :
- terrain horizontal, ou en faible pente, ou nivelé, même s’il doit être découpé en plusieurs parcelles situées à des niveaux différents, séparées par des murets ;
- terrain bien exposé, c’est-à-dire dégagé au sud, protégé des vents. Les fonds de vallées encaissées, où les gelées sont fréquentes, sont défavorables ;
- sol profond (30 cm minimum au-dessus de la roche mère) et le plus riche possible.
Il faut insister sur le fait que, si le jardinage biologique permet, grâce au compostage, aux engrais verts et à la couverture du sol, d’améliorer à la longue un sol médiocre, il n’y a en revanche rien à faire pour remédier à une mauvaise situation.
Potager : pratique et écologique
Un jardin potager peut être minuscule, voire se réduire à une jardinière sur un balcon ou dans une cour : les possibilités d’organisation sont alors limitées. Mais si on dispose d’une véritable parcelle de terre, on a à cœur de rendre son potager productif et écologique tout en lui conférant un certain charme, voire de l’esthétique.
Un potager circulaire, en spirale ou pointilliste, pourquoi pas ? Le jardin est un lieu où chacune et chacun s’expriment. Mais la ligne droite et le rectangle, souvent employés dans les potagers, ne sont pas contradictoires avec l’écologie et la biologie. Ils sont surtout bien pratiques quand il s’agit de planter, semer, entretenir, circuler au quotidien ! Le foisonnement végétal, la multiplicité des espèces, font vite oublier la rigueur initiale du plan.
Bref, s’il est un stade où le jardinier doit faire preuve d’autorité, c’est au moment de la conception spatiale de son jardin potager. Il a tout le loisir, ensuite, de laisser faire la nature… C’est ainsi que l’on privilégiera :
- dans les grands jardins (plus de 200 m²), une allée principale large de 80 cm au minimum pour permettre le passage d’une brouette ;
- un coin de compostage proche de l’entrée et pas trop éloigné de la cuisine (pour limiter les déplacements), abrité du soleil par des arbustes (noisetiers, sureaux, groseilliers, etc.). Les espaces libres doivent être suffisants pour permettre les mouvements (5 m minimum entre les lignes d’arbustes) ;
- pour réaliser les premiers semis, des châssis ou ados exposés au sud, abrités au nord et situés pas trop loin de la maison pour limiter les déplacements lorsqu’il faut aller ouvrir ou fermer les châssis ;
- des parcelles cultivées (planches) de largeur constante (1,10 à 1,30 m, de façon à pouvoir accéder facilement au milieu), séparées par des sentiers de 30 cm. La pomme de terre ou le potiron peuvent occuper plusieurs planches contiguës, ce qui entraîne la suppression provisoire des sentiers. La culture en planches n’empêche pas d’associer des cultures car chaque planche peut comporter de 2 à 5 lignes. Elle présente l’avantage de découper le potager en parcelles égales que l’on peut numéroter. Il est alors facile d’organiser une rotation des cultures. Il est utile, pour les repérer, de piqueter chaque coin de planche. Pour éviter de se faire mal en trébuchant sur les piquets (20 cm de hauteur environ), préférer les matériaux souples, comme des baguettes de noisetier ou de saule, aux piquets en bois ;
- un point d’eau pour remplir les arrosoirs ou brancher les tuyaux. L’idéal est une réserve d’eau de pluie (citerne, bassin) raccordée aux descentes de gouttières d’un bâtiment ;
- des lianes, arbres et arbustes fruitiers plantés à la périphérie du potager (de préférence à l’ouest et au nord), pour éviter que les légumes ne se trouvent à l’ombre et pour servir de brise-vent. En plein potager, les arbres rendent l’entretien et la circulation plus difficiles.
Ornement : un peu de méthode ne nuit pas
Au jardin d’ornement, quelques grands principes facilitent l’aménagement :
- commencer modestement, pour se faire la main ;
- regarder par-dessus la haie des voisins pour vérifier ce qui se voit et s’avère plaisant ! ;
- tracer des allées pratiques en suivant tout simplement la trace naturelle des cheminements de la famille, à recouvrir de broyat, de petits graviers ou d’un dallage (penser aux allées simplement tondues, traces dans l’herbe qui gardent les pieds au sec mais ne nécessitent aucun désherbage) ;
- faire un plan préalable à l’échelle, à partir d’un plan de masse, afin de vérifier sur le papier que les rêves sont à la mesure du jardin ;
- s’inspirer de l’organisation permacole et disposer près de la maison les zones utiles, et des zones de plus en plus sauvages, où l’on intervient peu, en s’éloignant ;
- piqueter sur le terrain avec de petits piquets et une ficelle ou en déroulant un tuyau d’arrosage pour matérialiser au sol l’emplacement des projets (massifs, cabane, arbres, haies, terrasse…) ;
- ne pas disperser des plantes partout et planter par groupes, en respectant des hauteurs variées, comme dans la nature (les plantes aiment vivre en compagnie et se développent mieux en groupe ; c’est le principe des écosystèmes) ;
- laisser des parties dégagées, comme autant de respirations dans le jardin (pelouse, prairies, massifs bas).
Jean-Paul Thorez et Brigitte Lapouge-Déjean
Faut-il ou non des sentiers ?
Les sentiers peuvent être enherbés et c’est bon pour le sol. Mais il faut, dans ce cas, couper l’herbe de temps en temps à la houe, à la cisaille à bordure, à la faucille ou à la tondeuse à fil. Il est aussi possible de couvrir allées et sentiers avec de la paille, des copeaux, de la sciure de bois, des écorces, etc. Le dallage est une bonne solution pour les petits potagers.
Mais, s’ils ont l’avantage de structurer un potager en parcelles, les sentiers prennent de la place et sont un lieu privilégié d’envahissement par les adventices vivaces (rumex, renoncule, etc.). Dans les petits jardins, on pourra se passer de sentiers. On couvrira alors systématiquement les interlignes et on numérotera les lignes de façon à permettre une rotation des cultures.