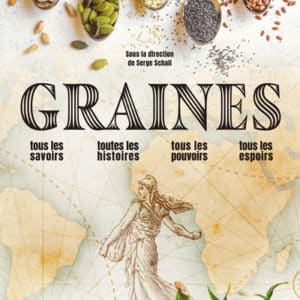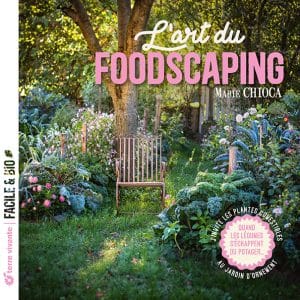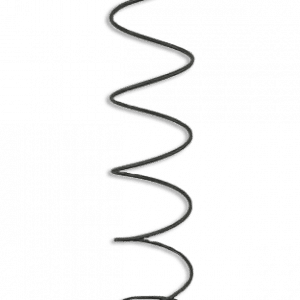Pour la sécurité
L’enjeu de la sécurité est crucial : comme nous l’avons expliqué dans le livre Poêles de masse – Pour un chauffage confortable, économique et écologique, les différentes étapes (conception, construction et utilisation) s’influencent les unes les autres et il est indispensable de bien travailler à ces trois niveaux pour réussir son poêle de masse.
Attention, négligences et précipitation peuvent entraîner des dysfonctionnements : combustion incomplète, fuites de gaz toxiques, dommages sur l’appareil voire incendies !
Quelques conseils pour le chantier
L’état d’esprit
Tranquillité et méticulosité : n’essayez pas d’aller vite, c’est le meilleur moyen de rencontrer des problèmes. N’hésitez pas à refaire pour que ce soit bien fait : vous travaillez pour longtemps !
Travail d’équipe : pas besoin d’être plus de trois ou quatre sur un chantier (sauf s’il y a beaucoup de briques de récupération à nettoyer ou de la bauge à mélanger). Prenez le temps de vous coordonner, de communiquer clairement et répartissez-vous les tâches selon les compétences de chacun.
Il est assez idéal d’avoir deux personnes à la maçonnerie et une qui s’occupe des coupes, des mélanges de mortier et de l’approvisionnement en matériaux. Ce dernier poste est assez crucial et très plaisant… contrairement à ce qu’on pourrait penser : on a l’œil sur tout avec un certain recul et on voit avancer les différentes parties en parallèle. Si ce poste est bien pris en charge, les personnes qui maçonnent restent concentrées car elles ne manquent jamais ni de briques ni de mortier. Si l’on envisage de faire une rotation des tâches, garder les mêmes postes pendant au moins une demi-journée, voire une journée entière, permet de s’approprier les gestes et les enjeux et de ne pas perdre trop de temps en formation…
Respect des principes essentiels : croiser les joints, bâtir de niveau et d’aplomb, vérifier l’alignement, gérer la dilatation et gérer l’étanchéité.
Confort de travail : de manière générale, plus le chantier est propre et organisé, plus le travail est de qualité et agréable. Pensez à ranger le chantier tous les soirs, à bien nettoyer les outils dès qu’ils ne servent plus (surtout avec le coulis silicaté ou le ciment réfractaire) et à centraliser les outils sur un plan de travail.
Précision et application : les coupes doivent être précises et nettoyées pour que les joints collent bien. C’est à faire au poste de coupe, pas à la pose. Le respect des cotes conditionne l’épaisseur de joint et la compression de la natte céramique. Un poêle de masse, c’est de la maçonnerie de précision !
Le rangement du chantier
Le matériel et l’organisation sur le chantier
La scie à eau sur table est très appréciable pour toutes les coupes de briques, en particulier réfractaires. En effet, celles-ci sont extrêmement dures et le fait d’arroser la lame permet à la fois de refroidir celle-ci pendant la coupe et de capturer la poussière (l’alumine est un irritant respiratoire). Cela permet de travailler sans masque et sans danger (mais avec un casque anti-bruit !). La location de ce type de machine coûte environ 400 € par semaine ; c’est un coût non négligeable mais nous la recommandons vivement pour toute construction de poêle en briques non prédécoupées à l’avance.
Installez la scie à eau à l’extérieur hors du passage (risque de projection de briques) et rangez régulièrement les chutes pour pouvoir les réutiliser quand c’est possible.
Établi extérieur : installez un établi (une planche sur des tréteaux) à proximité immédiate de la scie à eau pour les tracés, les soudures éventuelles…
Éclairage : chaque poste de travail doit être bien éclairé. Prévoyez des spots si nécessaire.

La scie à matériaux sur table avec lubrification hydraulique est bien plus agréable, sécurisée et efficace qu’une meuleuse.
G. Oonk |
Le matériel nécessaire pour construire un poêle en brique
EPI incontournables
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Gants
Casque de protection des oreilles pour les coupes
Masque à poussière performant
Nettoyage
Balai, balayette, pelle, brosse, chiffons, éponge, etc.
Outillage individuel
Mètre, crayon, cutter, chiffon (à garder dans sa poche)
Préparation des mortiers
Perceuse (800 W) avec arbre de malaxage à peinture (pour le coulis réfractaire)
Malaxeur manuel (1 800 W) pour le mortier de briquetage ou petite bétonnière pour le mortier de terre
Au moins 3 poubelles de 45 l (si vous utilisez un malaxeur manuel)
3 seaux au minimum
Repérage et tracé
Crayons, mètres, grande équerre alu, fausse équerre (pour reporter les angles), cordeau à tracer, ficelle, pelles, fil à plomb ou niveau laser
Prévoir un bon éclairage : 2 sur pied et 1 baladeuse et/ou 1 frontale
Maçonnerie
Quelques truelles : de taille normale, langues de chat, fers à joints, platoirs et lisseuses
Maillets en caoutchouc (1 par personne)
Niveaux à bulle : un petit (30 cm) et un grand (60 cm) par personne qui maçonne, plus un grand (1 m)
Règles de maçon : 1 m et 2 m
Auges de maçon (au moins 2) ou seaux (prévoir au moins un récipient par personne)
Massette (1 800 g)
Serre-joints, à pompe ou à vis mais pas de maçon (les coups portés descelleraient les briques)
Éponge
Chutes de contreplaqué (ou autres) pour les gabarits
Pinceau large à virole coudée ou balayette pour lisser les joints à l’intérieur des conduits (une éponge fait aussi l’affaire)
Poste à souder, indispensable pour faire des clapets sur mesure
Découpe
Ciseau à briques
Râpe diamant à carrelage
Coupe-briques (pour les BTC surtout)
Scie à matériaux manuelle
Meuleuse d’angle (ou disqueuse) de 900 W, disque de 125 mm minimum, avec disque diamant de qualité + disques métal
Disque à surfacer
Scie à eau sur table (indispensable pour un poêle de masse sur mesure, inutile pour un poêle en kit)
Petits conseils de base à propos de la maçonnerie
Soigner l’implantation
L’implantation est un moment crucial qui conditionne le déroulement du chantier. Le point de référence est toujours l’axe du conduit de fumées. Laissez à cet emplacement une ficelle plombée (mettez-la de côté pour ne pas être gêné et, au besoin, remettez-la en place).
Prenez le temps de tracer au sol tous les repères utiles en débordant au-delà de l’ouvrage : dimensions du foyer, section des conduits, épaisseurs utiles pour les isolants, les matériaux de parement, l’épaisseur des enduits. En fonction des cotes finies tout compris, vérifiez les alignements avec l’existant. Les murs de guingois de vieilles bâtisses compliquent la réalisation d’un alignement… mais ils donnent droit à l’erreur, plus que ceux des maisons neuves où tout est d’équerre.
N’hésitez pas à lâcher l’équerre et à reculer de quelques pas : rien ne doit choquer l’œil ! C’est le dernier moment pour apporter des modifications aux plans si besoin.
Astuce
Même si le fil à plomb reste un outil indispensable, ne vous privez pas d’un bon niveau laser (vert mieux que rouge). Il permet de prendre des aplombs sans monter au plafond et de mesurer des alignements entre un plan existant (mur) et un plan virtuel (futur poêle).
Généralités
Avant de maçonner un rang, faites toujours un montage à blanc des briques pour vérifier et ajuster les épaisseurs pour le réfractaire (seule dimension qui varie par rapport au standard) et les longueurs. Notez les joints sur le rang en dessous et numérotez éventuellement vos briques. Quand un rang est parfaitement posé à blanc, laissez-le en place et déplacez seulement les 2 ou 3 briques que vous posez pour libérer le lit de pose. Les briques qui restent en place servent de repère. Nous conseillons de ne pas faire trop de coupes à l’avance, à moins d’être parfaitement sûr de vos cotes et du nombre requis.
Pendant le montage, assurez-vous que les joints entre les briques sont toujours bien pleins. Il vaut mieux les faire déborder et enlever le surplus. Raclez régulièrement ce qui déborde et utilisez le surplus pour regarnir les zones qui le méritent. À la fin de chaque rang, nettoyez les joints avec une éponge humide (ou une taloche éponge). Pour les habillages en briques apparentes, serrez les joints de mortier au fer à joint au fur et à mesure avant durcissement complet.
Pensez à vérifier régulièrement l’aplomb par rapport au premier rang. La tolérance de faux aplomb en maçonnerie est de 2 mm par mètre . Surveillez l’équerrage qui peut facilement vriller.
La maçonnerie du foyer et des parties en brique réfractaire
Pour la partie réfractaire, les briques sont très régulières, ce qui permet de réaliser des joints très fins (1 à 3 mm). Ceux-ci doivent avant tout être bien remplis : mieux vaut qu’ils débordent légèrement dans toutes les directions.
Installer des cordeaux permet de bâtir bien d’aplomb et de ne pas vriller l’équerrage. Pour garder le cordeau bien tendu, n’hésitez pas à l’abouter sur un morceau d’élastique textile, tout en conservant la liberté de le repousser en cas de besoin pour passer vos briques d’angle. Si les guides à cloison sont assez gênants pour bâtir un foyer, ils sont bienvenus pour maçonner un mur accumulateur par exemple.
Les briques sont à couper prioritairement à la scie à eau pour limiter la poussière et pour obtenir une coupe plus facile et précise. Certaines coupes particulières demandent quand même de finir le travail à la petite meuleuse, avec un bon disque diamant.
Astuces
1. Numérotez les briques lors de la coupe en fonction de leur implantation dans l’ouvrage et la cote notée dessus. Regroupez-les soit par rang, soit par taille.
2. Regroupez les chutes par taille : si vous avez besoin d’un petit morceau, vous le trouverez facilement. Pas besoin d’entamer une brique neuve !
3. Si vous devez rattraper un faux niveau au-delà de l’épaisseur souhaitée de joint mince, pensez à intervertir des briques car leur épaisseur varie de +/- 1mm. Une brique plus épaisse ou plus fine est parfois pratique !
La maçonnerie des briques en terre crue
Ce qui vaut pour les briques de terre crue vaut aussi pour les briques cuites, sauf exception indiquée, que ce soit pour les coupes, les mortiers, les calepinages…
L’importance de l’expérience
Il est utile de suivre une formation à la construction en terre (maçonnerie terre crue, bauge, enduits), a minima de se documenter sur des livres et des ressources en ligne (voir fiches sur le site www.asterre.org). Rien ne vaut l’expérience sensible du travail des matériaux et de la pratique des tests de formulation !
Coupes : si elles sont bien sèches, les briques sont faciles à couper au marteau coupe-brique lorsqu’il s’agit de coupes droites. En brique apparente, ou lorsque les coupes ne sont pas droites, la scie à eau est plus indiquée pour faire des coupes bien nettes et de gagner du temps.
Si les BTC ne sont pas stabilisées, elles fondent avec l’eau de la scie à eau. Il vaut mieux alors éviter d’arroser la lame de la scie (conseil non valable pour les briques cuites), la coupe produit alors beaucoup de poussière.
Mortier de terre : pour avoir un bon mortier, selon l’argile disponible, ajoutez plus ou moins de sable. Il est indispensable de faire des tests préalables au chantier afin d’être sûr des proportions de votre mélange. Le mortier doit être bien collant mais ne pas se fissurer au séchage ni s’effriter (risque de descellement de briques). Il existe des tests simples pour formuler un mélange ajusté avec la bonne proportion sable-argile.
Mortier de chaux : vous pouvez aussi utiliser du mortier de chaux tendre (NHL 2 ou 3,5 par exemple). Les briques doivent alors être humidifiées (trempage express pour les briques crues, trempage long pour les briques cuites). La qualité du sable influence fortement la formulation et la qualité du mélange.
Coulis silicaté : si les BTC sont très régulières, on peut les coller en joints minces pour un ouvrage plus rigide. C’est aussi valable pour des briques cuites posées sur chant, ce qui évite l’affaissement en cours de pose, surtout pour les pièces de grande dimension.
Joints : pour la maçonnerie des BTC, ils sont en général de 10 à 12 mm d’épaisseur, ce qui permet beaucoup plus de souplesse que dans la maçonnerie à joints minces.
Réglage : posez plusieurs briques d’affilée (3 à 5 en moyenne) puis réglez-les ensemble au niveau ou à la règle. Évitez de retoucher après coup une brique qui a commencé à se figer : si le mortier n’est plus plastique, la brique risque de se décoller ; il faut alors enlever le mortier et recommencer.
De façon générale, c’est lors du premier contact que la liaison d’argile est la plus forte ; plus on fait bouger des briques après les avoir collées, plus on fragilise le joint.
Fabrication et mise en œuvre de la bauge
La bauge est un mélange qui se rapproche fortement d’une couche d’enduit de corps mais avec moins d’eau. Le mélange étant plus ferme, on peut bâtir en plus fortes épaisseurs tout en ayant peu de retrait. Selon les proportions et l’humidité, on se rapproche plutôt d’un torchis (plus fibreux) ou d’un mortier (moins fibreux et plus aqueux). Les limites entre les modes constructifs sont ténues et on peut adapter la formulation à son besoin.
Il existe diverses méthodes pour préparer la bauge : au bulldozer pour les grosses quantités (maison entière) ou au malaxeur planétaire pour quelques mètres cubes (poêle). On peut également la préparer par foulage au pied dans une bâche (fort besoin en main-d’œuvre) ou par trempage (pour les petits volumes).
La construction en bauge permet de fabriquer les trappes en coulant du béton dans un pot de fleur conique. La bauge est alors moulée directement autour du pot contenant le bouchon.
Astuces techniques
Voici des astuces qui peuvent servir pour les postes qui présentent des enjeux d’étanchéité, de complexité technique. Ces conseils sont loin d’être exhaustifs et ne conviennent pas à toutes les situations. En cas de doute, n’hésitez pas à poser vos questions sur les forums dédiés aux autoconstructeurs et/ou à appeler un poêlier.
Coulage des pièces en béton réfractaire
Pour les pièces de forme ou les linteaux, il est pratique de couler un béton réfractaire. Il peut être dense (ciment alumineux + chamotte réfractaire) ou allégé (à base de vermiculite). Le béton dense est très pratique pour couler des pièces en place, comme les linteaux.
Des dosages et astuces de mise en œuvre sont proposés dans le manuel de construction du Poêlito. On peut ainsi fabriquer des pièces soumises au feu plus résistantes que certaines briques isolantes.
Recette du béton réfractaire vibré
Pour réaliser des pièces aux formes spéciales, certains réfractoristes proposent un mélange de béton réfractaire prêt à l’emploi, voire fabriquent des pièces à la demande. Vous pouvez aussi utiliser du Ciment Fondu® mélangé à de la chamotte de granulométrie variée (0 à 10 mm), selon les proportions indiquées par le fabricant du ciment (en général, 1/3 ciment et 2/3 chamotte).
Coulez votre mélange, bien ferme et assez sec (toujours très peu d’eau !), dans un moule de coffrage en contreplaqué par exemple, bien huilé pour faciliter le démoulage. Vibrez (aiguille ou table vibrante) ou tassez fortement à la massette pour chasser les bulles d’air qui fragiliseraient la pièce. Si le mélange est trop liquide, le vibrage fait sédimenter tout l’agrégat au fond.
Laissez prendre à l’ombre, couvert d’un plastique, durant 12 heures minimum avant de démouler. Idéalement, arrosez le béton régulièrement pendant la prise. Selon la qualité du ciment, du mélange et du vibrage, vous obtenez un moulage aux propriétés similaires à celles de la brique réfractaire. Il est impératif de laisser sécher correctement avant la mise à feu et de permettre une montée en température très progressive des éléments, sans quoi les propriétés du matériau s’en trouvent dégradées.
Fixation de la porte foyère
Notre technique préférée est le pré-cadre en cas de fixation en retrait de la façade ou le système de cornières sur tout le tour de la porte. Ainsi rien n’est fixé dans la brique, seulement retenu par la façade. Si vous devez fixer dans la brique, préférez des trous en façade avant plutôt que dans les parois internes du foyer. Laissez toujours un jeu fonctionnel de dilatation et assurez-vous que la porte reste démontable.
Finitions et enduits
Ce sujet mériterait un livre à lui tout seul. Ça tombe bien, il existe déjà de nombreux ouvrages qui déclinent des méthodes d’enduits en matériaux naturels, la plupart peuvent convenir à apporter la touche finale à un poêle de masse.
Pour les surfaces verticales, nous recommandons les enduits en terre, mélange d’argile, de sable et de fibre végétale. N’oubliez pas de poser une plinthe au contact du sol, incorporée dans la couche de corps, qui servira d’arête pour la finition et protègera l’enduit des coups de balai. Elle peut aussi être installée en même temps que le carrelage.
Pour les surfaces horizontales, nous préférons les matériaux durs qui résistent mieux aux chocs et à l’eau : dalles de pierre, carrelage, tommettes, ardoises par exemple.
Les enduits à la chaux ou au plâtre sont tout à fait utilisables, mais leur mise en œuvre requiert plus de technique.
Les enduits d’argile
Comme la plupart des enduits, on les réalise en deux couches : une couche de corps (dressage des parois, finalisation de la forme et renfort) puis une couche de finition (texture, couleur, résistance). Les enduits à l’argile sont souvent moins résistants qu’un enduit à base de chaux, mais leur mise en œuvre est moins technique.
La couche de corps est un mélange d’argile, sable et paille, parfois additionné de bouse ou de crottin. Ces derniers ne sont pas indispensables mais ils apportent des fibres fines, de l’onctuosité et de la solidité à l’enduit.
Si l’on enduit sur des matériaux différents, il faut avoir une bonne proportion de fibres pour bien armer cette couche d’enduit avec une trame en fibres de verre (trame de 10 mm) ou de jute (maillage large) pour réduire le risque de fissuration.
Une trame est aussi utile pour renforcer un enduit dans les parties fragiles : arêtes, parties étroites par exemple. On peut aussi utiliser des baguettes d’angle pour les angles vifs ou arrondir les angles qui seront ainsi moins fragiles.
La couche de finition, qui vient après la couche de corps, est plus fine et apporte lissage et couleur. C’est un mélange d’argile colorée (ou chaux et pigment) et de sable plus fin, avec ou sans fibre. La qualité de la couche de corps conditionne le résultat de la finition.
Il est possible de réaliser un stuc par-dessus la finition, pour une texture lisse et brillante. Cette solution naturelle et économique nécessite un peu de technique.
Le mortier « parisien creusois » (MPC)
Composé de plâtre pour le collant et la possibilité de mettre des épaisseurs importantes, de chaux pour la résistance et de sable (fin) pour économiser les matériaux, cet enduit permet, en couche relativement épaisse, d’obtenir un lissage très proche d’un stuc ou d’un tadelakt. Les proportions habituelles (3 plâtre + 2 chaux aérienne + 1 sable) peuvent être inversées à l’envi. Notre préférence va à « 3 sables + 2 chaux + 1 plâtre » qui donne la possibilité d’ajouter une forte proportion de pigment et permet un comportement moins proche d’un enduit plâtre. Cet enduit nécessite de maîtriser la mise en œuvre du plâtre.
Badigeons et peintures
Pour changer la couleur de son poêle, on peut le peindre avec des peintures naturelles. Il existe une infinité de recettes maison ou du commerce : à base d’argile, de caséine, de chaux, de colle de farine ou de peau de pomme de terre, de silicate, etc. Si vous achetez de telles peintures, vérifiez la composition car sous certaines appellations de peinture « naturelle », on trouve des résines issues de la pétrochimie qui n’ont rien d’écologique et qui, en chauffant, risquent de faire des émanations toxiques.
Peinture au silicate maison
N’hésitez pas à expérimenter une peinture maison composée de silicate et de pigment, avec ou sans agent de charge pour obtenir une peinture très couvrante, bon marché et résistante. Réalisez des essais au préalable pour éviter la détérioration de teinte (réaction chimique) et le poudrage.
Les traitements de surface
Les durcisseurs sont très pratiques pour réduire l’entretien des surfaces peintes ou enduites. Attention, certains rendent impossible la reprise ultérieure d’un enduit traité. D’autres, à base de cires latex ou de résines, sont à réserver aux parties à basse température. Pour les parties chaudes (poêles réactifs, parties en simple peau), privilégiez les matières minérales.

Poêle en terre crue, enduit terre (réalisation Habiterre, France).
S. Moreteau |
Pour durcir les enduits
Silicate en solution : on peut badigeonner un enduit en terre d’une solution de silicate (1/3 eau + 2/3 silicate), qui est un durcisseur et un bouche-pores. Ce mélange est transparent, sans charge et on peut y ajouter des pigments. On l’applique au pinceau comme une peinture. Non adapté aux enduits plâtre.
Huile de lin : elle peut être utilisée sur les enduits terre, comme sur les sols. Siccative, elle durcit à l’air. Sa prise est assez longue et le support reste collant tant qu’elle n’est pas terminée. On peut y ajouter des siccatifs pour accélérer le durcissement. Elle produit un revêtement hydrophobe imperméable, mais fonce un peu la teinte et rend l’enduit difficile à reprendre en cas de détérioration par impact.
Cire de carnauba : l’application d’une cire composée de carnauba et de cire d’abeille avec un solvant (térébenthine ou pétrole désaromatisé) donne un fini brillant, de la dureté et rehausse la teinte si elle est additionnée de pigments. Non adaptée aux parties très chaudes de l’appareil.